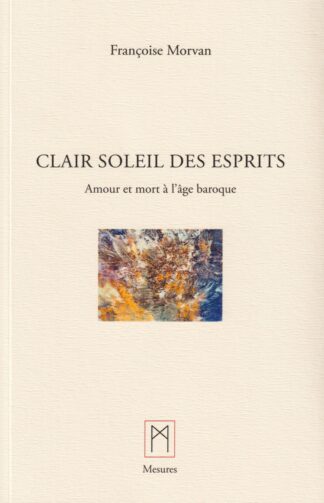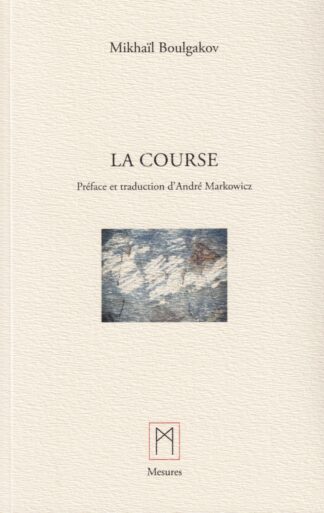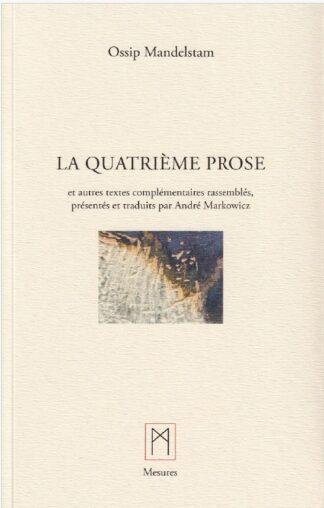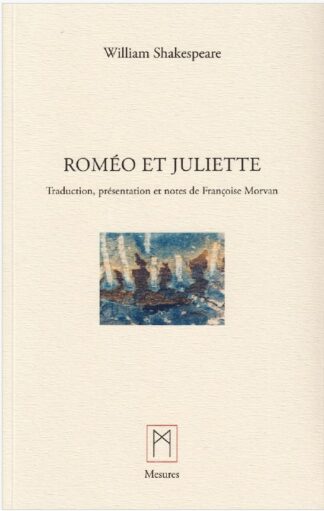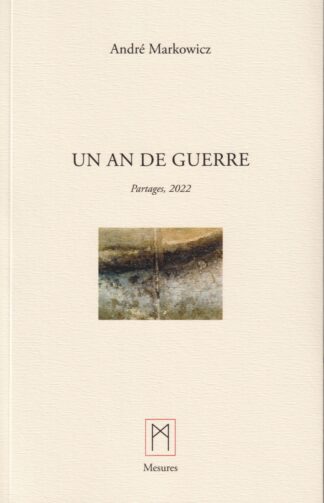https://lichen-poesie.blogspot.com/p/note-de-lecture_47.html
Catégorie : Échos
‘Les Juifs’, Evguéni Tchirikov, 1903 dans la revue K

Le grand traducteur André Markowicz n’avait jamais entendu parler des Juifs, pièce de théâtre d’Evguéni Tchirikov, avant qu’il ne la découvre par hasard. Il l’a traduite et fait paraître chez Mesures, la maison d’édition qu’il a créée avec Françoise Morvan. Nous publions la fin du premier acte et le début du deuxième de cette œuvre singulière dans l’histoire de la littérature russe. Écrite juste après les grands pogroms de Kichinev de 1903 et 1905, elle témoigne d’une compréhension et d’une empathie exceptionnelles à l’égard de la situation des Juifs russes au début du XXe siècle.
L’histoire a lieu dans une des villes de la limite de peuplement, dans la province du Nord-Ouest. L’action se déroule dans l’appartement et la boutique de l’horloger Leiser Frenkel. On y voit la famille de ce dernier, les amis – juifs et non-juifs – de son fils et de sa fille. On y parle fiévreusement de la situation des Juifs de la Russie dans la période qui précède la révolution. On y débat sur le sionisme et l’assimilation, l’exil et la religion, le socialisme et l’Amérique, Marx et le Talmud. On évoque les pogroms passés alors que bruissent des rumeurs de pogroms à venir…
Dans cet extrait, on découvre quelques-uns des personnages, ainsi décrit par Evguéni Tchirikov :
LEÏSER FRENKEL, vieillard d’une soixantaine d’années à la grande barbe argentée et aux épais sourcils tombants ; sa silhouette rappelle celle d’un patriarche de la Bible. De profession, il est horloger.
LIA, sa fille, jeune fille de 18 ans, lycéenne, exclue pour participation à des désordres étudiants.
BORUCH (Boris), son fils, 22 ans, étudiant exclu de l’Université pour participation à des désordres. [Boruch est communiste]
NACHMAN, 26 ans, homme de petite taille, brun maigre aux yeux fiévreux, exalté. Beaucoup pensent qu’il a les nerfs malades. [Nachman est un fervent sioniste]
BÉRÉZINE, camarade de Boruch, russe, ancien étudiant. Un grand blond maigre, il parle toujours d’un ton tranquille, parfois mou, mais toujours réfléchi ; il aime accompagner ses discours de cette phrase : « c’est vrai, ça ». [Il n’est pas juif]
IZERSON, ouvrier dans une usine de mécanique ; taciturne et renfermé, il parle d’une voix de basse ; il porte une blouse bleu sombre, il a les yeux toujours baissés ; quand il s’anime, il se met à crier en agitant ses longs bras maigres.
MACHA, la bonne chez Leïser Frenkel.
SCHLOÏME, jeune homme de 19 ans, apprenti horloger chez Frenkel.
*
[Fin de l’acte premier]
NACHMAN. — Nous avons besoin de combattants ! Et nous en avons ! Ils réveillent le peuple juif après un sommeil millénaire, ils raniment en lui la foi qui était en train de s’éteindre… Et, Dieu soit loué, le peuple a encore beaucoup de forces ! Après toutes les persécutions et les souffrances qui ont accablé les Juifs pendant deux mille ans, le peuple répond à l’appel de ses combattants ! Notre devoir est d’aller à la rencontre de sa conscience… Nous devons l’amener à la renaissance ! (À Boruch.) Si le peuple n’a pas encore recouvré toutes ses forces et s’il ne croit à sa renaissance que faiblement, nous devons lui insuffler de l’âme ! Voilà quel est le premier devoir de notre intelligentsia ! Vous devez lever votre voix pour la défense de notre peuple malheureux !
LEÏSER (hochant la tête). — Oui, oui !
NACHMAN. — Vous devez proclamer haut et fort, au monde entier, que le peuple juif est encore vivant !
LEÏSER. — Oui, oui !
NACHMAN. — Oui, crier ! Et vous — vous vous taisez !
IZERSON (bondissant de son coin, vers Nachman). — Mais vous, les sionistes, qu’est-ce que vous pouvez nous donner, à nous, les ouvriers et les artisans ? Vous exigez qu’on travaille et qu’on se sacrifie pour votre idéal, qu’on se tienne à l’avant-garde de votre mouvement…
NACHMAN. — Oui ! Si vous êtes juif, vous devez le comprendre !
IZERSON. — Je suis juif et je ne comprends pas… Qu’est-ce qu’ils peuvent nous donner à nous, ouvriers et artisans juifs, vos idéaux ? Vous nous consolez par une vie heureuse en Palestine… Mais pourquoi, pour nous, sera-t-elle heureuse ?… Vous ne nous dites rien sur ce que nous devons faire maintenant… Or, nous, nous ne pouvons plus vivre comme ça ! Nous ne pouvons plus ! Nous mourons de faim, on nous force à nous bouffer les uns les autres… nos enfants n’ont pas de lait !
NACHMAN. — Je vous ai déjà dit que la cause de votre misère réside dans la situation contre-nature qui est celle du peuple juif.
BÉRÉZINE. — Nous pensons que cette situation est contre-nature pas seulement chez les Juifs.
NACHMAN. — Mais où est-elle naturelle, finalement, cette situation ?
IZERSON. — Sur la lune, monsieur Nachman ! (Rires de ceux qui l’entourent.)
NACHMAN (avec colère). — Alors, il ne vous reste qu’une chose à faire : vous installer sur la lune.
IZERSON. — À quoi bon ? Nous essaierons de faire quelque chose ici, sur terre.
NACHMAN. — Voilà, c’est ce que je vous propose de faire en Palestine !…
IZERSON. — Pourquoi seulement en Palestine ? Ce n’est pas ça qui compte pour nous. Vous, les sionistes, vous voulez avoir un État, mais qu’avons-nous à en faire, nous, de votre État, si, là-bas aussi, nous rongerons des os ? Nous irons plutôt avec ceux qui rongent des os comme nous, — quels qu’ils soient — pour vivre et travailler ensemble… En ce moment, ce n’est pas ça qui manque, les gens qui rongent des os ! Il y en a qui mangent des tartes sucrées et d’autres qui rongent des os !… Eh bien, que les gens se divisent comme ça ! Vous n’indiquez aucun moyen de nous aider maintenant et vous voulez nous consoler avec vos rêves…
NACHMAN. — Pourquoi « mes » rêves ? Le sionisme est l’idée du peuple juif tout entier, et vous aussi, sauf erreur, vous êtes juif…
BÉRÉZINE. — Mais, vous, les sionistes, vous ne dites rien de la façon dont les ouvriers vivront en Palestine.
IZERSON (avec un geste de lassitude, il retourne vers son coin et se rassied). — Ça nous est égal, où vivre comme des bagnards : ici ou en Palestine…
BÉRÉZINE. — Je suis totalement d’accord avec Izerson !
IZERSON. — Nous voulons vivre ici et travailler ici ! Nous avons notre idéal à nous !
LIA (s’asseyant auprès de Nachman). — Nachman, je ne crois pas que, nous, les Juifs, nous puissions faire quelque chose de grand pour notre peuple… Par nous-mêmes, tout seuls ! Quand tout le monde vivra mieux, alors, notre peuple aussi, il vivra mieux…
NACHMAN. — Tout le monde vivra mieux ! Tout le monde ! Sauf que, nous, nous vivons toujours aussi mal qu’il y a mille ans. Est-ce que nous ne vivons pas dans un ghetto, comme on vivait au Moyen-Âge ? Est-ce qu’on ne nous cogne pas comme on nous cognait dessus au Moyen-Âge ? Est-ce qu’il y a une justice pour nous sur terre, une loi, un respect de la personne ? Il n’y en a pas ! Il n’y en a pas plus qu’avant ! Et il n’y en aura pas aussi longtemps que nous resterons en exil… Aidez le peuple à rentrer chez lui ! Proclamez qu’il est temps qu’il rentre chez lui, et conduisez-le là-bas ! Alors que, vous… vous vous taisez !
BORUCH. — Le souci principal des affamés, c’est de manger, — eux, ils n’ont pas le droit de parler de renaissance ! Votre renaissance, c’est juste le beurre grâce auquel le pain paraît encore meilleur. Le peuple a faim, on l’attire en Palestine avec du pain, et il y va… C’est en ça qu’elle consiste, votre « renaissance » ! Et n’empêche, en ce moment, certains en reviennent en courant… Il s’avère que, « renaître », c’est seulement possible quand on a un certain fond de roulement !…
NACHMAN (bondissant de sa place). — Vous calomniez votre peuple ! Vous ne le connaissez pas. Vous n’avez pas le droit de dire ça… C’est… c’est malhonnête !
BORUCH (piqué au vif). — Qu’est-ce que vous venez de dire ? Malhonnête ? J’exige des excuses ! (Tous les présents se regroupent autour de Nachman et Boruch qui viennent de s’insulter.)
LIA. — Boris ! Arrête !
LEÎSER. — Tu oublies que reb Nachman est notre invité ?
BÉRÉZINE. — Ce n’est pas possible, ça, messieurs !
NACHMAN (d’une voix accablée). — Bon, pardon ! C’est ma faute !
BORUCH. — Je n’ai plus rien à vous dire !
NACHMAN (tendant la main à Boruch). — Allez, c’est ma faute, je me suis emporté… Je vous présente mes excuses… Mais je me suis senti profondément insulté, et cette insulte était encore plus amère du fait qu’elle venait d’un Juif… (Boruch tend la main à Nachman.)
LIA. — Boris, plusieurs fois tu as été violent avec Nachman… (Elle s’écarte et se rassied, suivie par Bérézine, Nachman se remet à arpenter la salle.)
NACHMAN. — Quelle importance, cette violence ! Comment peut-on rester tranquille quand ce n’est pas votre langue qui parle, mais votre âme ? On ne peut pas !… N’importe qui a un point qui fait mal dès qu’on le touche. Moi aussi j’ai été violent… Mais il ne s’agit pas des mots… (Il se rassied sur une chaise, épuisé, et baisse la tête.)
LEÏSER (avec ironie). — Vous en arriviez presque aux mains pour Sacker !…
NACHMAN (d’une voix basse, pensif). — Des Sacker, nous n’en avons pas besoin… S’il faut vendre son âme, ce n’est pas la peine d’aller en Palestine…
BORUCH. — Pourtant, nous ne l’avons pas vendue, et nous n’y allons pas, en Palestine ? Ou bien, d’après vous, nous aussi, nous avons vendu notre âme ?
NACHMAN (avec lassitude). — Voyons ! voyons ! Je n’ai jamais pensé une chose pareille…
LEÏSER (à Boruch). — Tu veux toujours trouver un nœud où mettre ton crochet ! Tu as un très mauvais caractère. Tu seras malheureux dans la vie…
BORUCH. — Je ne me changerai plus ! Je vivrai, d’une façon ou d’une autre…
NACHMAN. — Je le disais tout à fait dans un autre sens… En Galicie, le Juif est privé de tous les droits, on lui ferme la porte des écoles, on l’écrase d’impôts, on lui refuse toute justice… Mais un Juif riche, Moritz Stern, qui a vendu depuis longtemps son âme au diable, qui a été jugé trois fois pour des crimes infects, se promène bras-dessus-bras-dessous avec le gouverneur en personne ! Quand on vend son âme (dans un sanglot), on n’a pas besoin de partir d’ici ! (Il s’essuie les yeux avec son mouchoir.)
BÉRÉZINE. — Mais vous avez les nerfs dans un état…
NACHMAN. — Bah ! Ça a des nerfs, un Juif ? Ça n’a pas de nerfs, ça n’a pas de cœur, ça n’a pas d’âme… ça n’a rien du tout !… (Les nombreuses pendules du magasin commencent à sonner les douze coups. Après cela, — courte pause générale. Lia chuchote quelque chose à Bérézine.)
LEÏSER (avec un soupir). — Dix ans que je veux que toutes mes pendules sonnent en même temps, ça ne m’est jamais arrivé. Elles sont comme les gens, elles ne sont jamais d’accord… (Il rentre, pensif, dans le magasin.)
RIDEAU
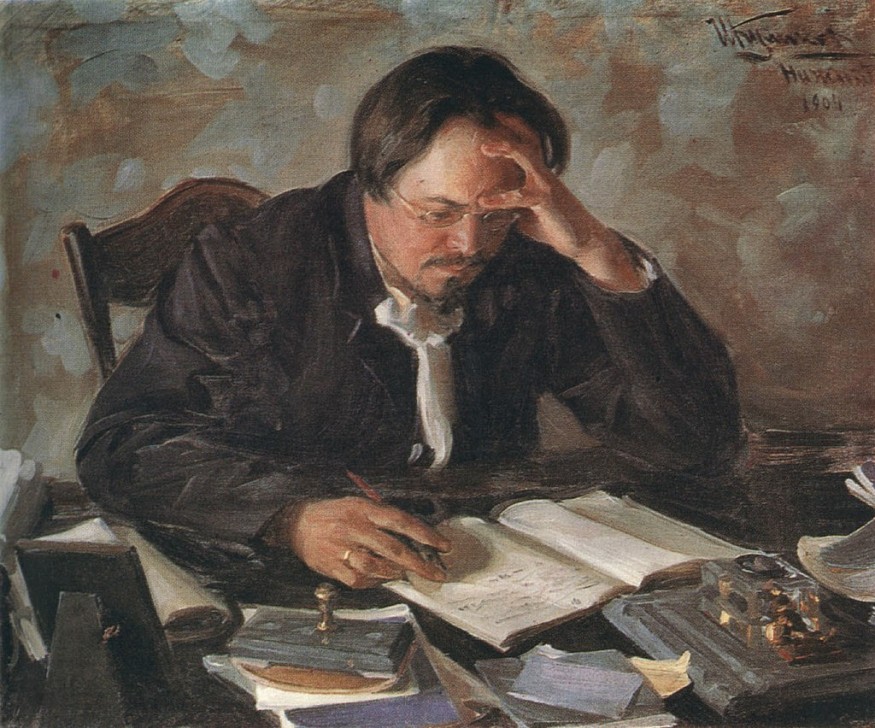
ACTE DEUXIÈME
Même décor. Le soir. Dans le magasin, à son établi, à la faible lumière d’une lampe verte de banquier, Schloïme travaille seul. Lia et Bérézine sont assis dans la salle plongée dans la pénombre du soir tombant. De l’autre côté du mur, on entend faiblement les accords en mineur d’un harmonium, quelqu’un joue un prélude de Mendelssohn. Au lever de rideau, Macha entre depuis les pièces intérieures, une lampe allumée à la main.
MACHA (posant la lampe sur la table qui est devant Lia et Bérézine). — Mademoiselle ! Donnez-moi mon compte…
LIA (étonnée). — Tu veux nous quitter ?… Pourquoi ? Il y a quelque chose dont tu n’es pas contente ?
MACHA. — Pourquoi — pas contente ? Je suis contente, mais… Allez savoir ! Avec tous les on-dit… J’ai peur, moi…
LIA. — Je ne comprends pas… (Schloïme, interrompant son travail, écoute les accords de la musique et soupire.)
MACHA. — Il y a des gens qui disent, quoi, qu’ils vont cogner les youpins… Et moi, n’est-ce pas… Tout le monde tient à sa peau, n’est-ce pas… Ils cognent, ils font pas le détail… (Pause.) Vous laisser, je vous laisserai pas, vous non plus vous pouvez pas rester sans personne, mais cherchez toujours…
LIA. — Bien. (Macha s’en va. Longue pause.) Chaque fois que j’entends dire qu’on agresse les Juifs, je sens que je suis une youpine… Et, dans le cœur, je sens remuer cette rancune envers… vous, les Russes, qui nous agressez…Et, là, je me mets à sentir ce lien avec mon peuple que, d’habitude, je ne ressens pas… C’est comme maintenant : en Bessarabie, à ce qu’on dit, on attend un pogrom.
BÉRÉZINE (avec tristesse). — Oui. J’ai entendu ça…
LIA. — Et je commence à ressentir de la rancune… même… envers toi…
BÉRÉZINE. — Est-ce que j’y suis pour quelque chose, Lia ? Est-ce que je ne suis pas un « youpin », pareil ? Moi aussi, on m’a persécuté toute ma vie, dès le lycée. J’ai grandi dans une famille pauvre. J’ai vu des gens puissants qui humiliaient mon père, qui humiliaient ma mère. J’ai grandi avec la haine et les frissons d’esclave devant ces gens qui étaient riches, bien habillés, puissants… J’ai toujours gagné mon pain en me sentant humilié. Pour les kopecks qu’ils me payaient pour les leçons, les copies, les plans — ils exigeaient que je plie le dos… On me laissait dans le vestibule comme un laquais, on me faisait comprendre à chaque pas que j’étais un miséreux et que le kopeck que j’avais gagné à la sueur de mon front, c’était la charité que me faisaient ces salopards repus et satisfaits… Voilà ceux que je hais, moi !… Ils m’ont mutilé l’âme : ils m’ont coupé les ailes ! Ils n’ont nourri en moi qu’une lâcheté infâme, ils m’ont persécuté pour la moindre tentative, pour le moindre élan de liberté… Je n’ai plus de force de volonté, mais de la haine envers eux, j’en ai beaucoup ! Moi aussi, je suis un « youpin »… Je ne me sens pas coupable devant toi…
LIA. — Tu n’es pas coupable. Ça, je le sais, et, malgré tout, je n’arrive pas à étouffer au fond du cœur cette petite note détestable. Je t’aime, et, en même temps, c’est comme si je t’en voulais… Et il y a quelque chose qui empoisonne la sincérité que je te dois… Ne m’en veuille pas, Vladimir ! Ce n’est pas ma faute… (Pause gênée ; les accords de l’harmonium résonnent faiblement de l’autre côté de la paroi.) Tu m’en veux ?
BÉRÉZINE (secouant la tête). — Non. Rien… C’est moche, tout ça. Je suis triste que les gens aient eu le temps de jeter dans ton cœur cette petite braise d’une haine absurde… Qui est-ce qui joue là-bas, comme s’il pleurait ?
LIA. — Un petit garçon malade, le fils de notre voisin… Un Juif… un jour, des gamins chrétiens l’ont attrapé et ils lui ont joué un mauvais tour : ils l’ont pris et ils l’ont baptisé dans une grosse barrique pleine d’eau de pluie. C’était l’automne… Il faisait froid. Il est tombé malade, il a perdu l’usage de ses jambes…
BÉRÉZINE (avec un soupir). — Oui, nos enfants, c’est presque au berceau qu’on leur inculque cette haine atroce… (La musique se tait.)
LIA. — Quand j’étais adolescente et que j’étais au lycée, il m’est arrivé quelque chose comme ça… Je n’oublierai jamais, jusqu’à la fin de mes jours… Jusqu’à maintenant, je n’arrive pas à ne pas y penser…
BÉRÉZINE. — Qu’est-ce qu’il t’est donc arrivé ?… (Pause.) Lia !
LIA. — Un enfant chrétien avait disparu, un petit garçon de quatre ans, et ils se sont mis à dire en ville que c’étaient les Juifs qui l’avaient tué.
BÉRÉZINE. — Ça, les Romains en accusaient les premiers chrétiens…
LIA. — Mes camarades de classe se sont mises à discuter pour savoir si, oui ou non, nous buvions le sang des chrétiens. Il y en a une qui s’est approchée de moi et qui m’a demandé : « C’est vrai ? » Elle avait un visage, comme ça, plein d’une joie méchante. Je la revois, comme si elle était devant moi… J’ai dit que c’était un mensonge. La petite fille insistait, les autres écoutaient et me dévoraient de leurs yeux curieux, comme si elles regardaient un animal… J’ai proposé d’interroger le prêtre. Pendant le cours de catéchisme, je suis entrée avec les autres dans la classe, et je me suis assise à côté de cette petite fille… Quand le silence s’est fait dans la classe, cette petite fille s’est levée et, d’un voix claire, elle a demandé au prêtre si c’était vrai…
BÉRÉZINE. — Qu’est-ce qu’il a dit ?
LIA. — Lui ? Il a dit que c’était une histoire obscure et qu’il ne pouvait pas l’affirmer, mais qu’il ne pouvait pas non plus répondre « non »… Il a dit ça comme ça !… Alors ma voisine s’est tournée vers moi et, assez fort, elle a chuchoté : « Alors, qui a raison ? » J’ai eu si mal, je me suis sentie tellement blessée que j’ai éclaté en sanglots… Le prêtre a demandé ce qui se passait et j’ai entendu une des élèves qui lui répondait tranquillement : « C’est une youpine ». (En chuchotant.) J’ai fait une crise de nerfs… (Elle se tait ; on entend à nouveau les accords de l’harmonium de l’autre côté de la paroi.)
BÉRÉZINE. — Lia ! Tu pleures, je crois bien… (Il lui prend la main.) Il ne faut pas pleurer, ma chérie…
LIA. — Non, je ne pleure pas, mais ça me fait mal de te le raconter… Comme si c’était arrivé juste hier… C’était une grande tragédie pour ma petite âme… Et, là, je me souviens de cette tragédie et j’ai l’impression qu’elle n’est toujours pas finie… et qu’elle ne finira jamais… jusqu’à la mort…
BÉRÉZINE (baisant les mains de Lia). — Pourquoi dire ça ? Il ne faut pas… Il faut l’oublier…
LIA. — Tout le temps que nous avons vécu à Pétersbourg, j’ai oublié que j’étais une « youpine ». Mais, maintenant, je n’arrive plus à me le sortir de la tête. Je te jure ! Sans doute que, jusqu’au fond du cœur, on se sent toujours un attachement inconscient à sa nationalité, à sa religion…
BÉRÉZINE. — Sa religion ?
LIA. — Oui. Notre religion ne me touche pas et il y a beaucoup de choses dedans qui me paraissent… ineptes. Mais parfois, quand j’entends mon père lire ses prières du shabbat, il y a quelque chose, d’un coup, qui remue dans mon cœur, loin, loin, au fond, je ne sais pas où, quelque chose qui me revient, quelque chose de proche, de familier, à moi, quelque chose que je me mets comme à plaindre, (baissant la voix), quelque chose qui gémit, mais qui gémit au fond du cœur, et j’ai les larmes qui me montent aux yeux. (Elle baisse la tête.)
BÉRÉZINE. — Mais c’est vrai que tu as envie de pleurer ? Arrête !
LIA. — Non. Rien. Je me sens triste, je ne sais pas. Je plains Nachman… Il doit avoir compris maintenant… (Les accords de l’harmonium s’arrêtent net.)
BÉRÉZINE. — Tu ne t’es pas encore expliquée avec lui ?… Il faut lui dire… Ce n’est pas bien…
LIA. — Je tarde toujours. Je le regarde et je le plains tellement, lui, que je n’y arrive pas… C’est quelqu’un de très bien. Mon père le considère avec une espèce de vénération… Moi aussi, il y a eu un temps où je le vénérais… Je lui dois vraiment beaucoup…
BÉRÉZINE. — C’est quelqu’un de très bien, mais il lui manque des connaissances. Il n’arrête pas de « découvrir l’Amérique ». Explique-toi avec lui au plus vite. J’ai l’impression qu’il a deviné… Il me lance comme des regards étranges… Il me hait. Et à ton père aussi, dis-lui…
LIA. — Ça, pour moi, c’est vraiment une torture ! Pour mon père, ce sera un coup terrible… Lui dire toute la vérité, — c’est comme prendre un couteau et le lui enfoncer dans le cœur de mes propres mains… Mais c’est aussi une torture, d’aimer et de se cacher, et d’avoir peur de minute en minute !… Je suis comme une criminelle : je vis avec la peur constante que mon crime se dévoile…
BÉRÉZINE. — Oui, aimer en cachette — ça ne me plaît pas non plus.
LIA. — J’envie ma sœur : elle, elle s’est fait baptiser sans aucune hésitation, elle s’est mariée à un Russe, et, maintenant, elle vit sa vie. Elle a complètement rompu avec la famille et elle ne plaint pas du tout son père… Mon père interdit qu’on prononce son nom…
BÉRÉZINE. — Elle a bien fait ! Qu’en avons-nous à faire, de nos parents ? Nous avons notre vie à nous, et nous avons le droit d’en faire ce que nous voulons. Il faut briser tout ce qui empêche de vivre… Toutes ces guenilles d’un bien-être présent nous gardent pieds et mains liés… C’est vrai, ça !
LIA. — Tu dis ça quand tu es avec moi. Mais, tes parents aussi, j’en suis sûre, tu comptes avec… Je sais qu’ils ne voient pas d’un bon œil notre relation…
BÉRÉZINE (avec un soupir). — Qu’est-ce que j’en ai à faire ? « Quand on part pour un nouveau monde, on ne peut rien emporter de l’ancien »… C’est vrai, ça !
LIA (pensive). — Chez toi, j’en suis sûre, tu leur répètes que je suis tellement gentille, que je n’ai pas du tout l’air juive !… C’est étrange. Quand vous voyez un bon Juif, auquel vous ne pouvez rien reprocher de mal, vous dites : « Il n’a pas du tout l’air juif. » Pourquoi ? Il est quand même un Juif, non ?…
BÉRÉZINE. — Lia ! Qui est-ce, ce « vous » ? De qui est-ce que tu parles ?
MACHA (apparaissant à la porte). — Le samovar est servi, mademoiselle ! (Elle veut repartir.)
LIA. — Macha ! Attends !
MACHA. — Oui, mademoiselle ?
LIA. — Tu me détestes ?
MACHA. — Mais enfin, mademoiselle ! Que le bon Dieu vous protège ! Pourquoi je vous détesterais ?
LIA. — Parce que je suis une youpine !…
MACHA. — Ben ça alors, mais pas du tout ! Mais vous êtes tellement belle ! De youpin, vous avez même pas ça (elle montre le bout de son petit doigt.) Je vous jure ! Personne pourrait le dire, que vous êtes une youpine…
LIA (avec ironie). — Je n’ai pas l’air d’en être une ?
MACHA. — Pas du tout ! De caractère, vous êtes totalement russe !
LIA (éclatant de rire). — Ah ben merci ! Va ! va !
MACHA. — Ah ben vraiment ! À peine on dit quelque chose, et…
LIA. — C’est bon ! c’est bon ! Merci pour le compliment ! (Macha s’en va.) Tu vois ?
BÉRÉZINE. — Tu parles d’une preuve ! (Lia continue de rire.) Lia, c’est une honte de faire attention un détail pareil.
LIA (cessant de rire d’un coup ; avec sérieux). — Et toi, tu n’as jamais rien dit de semblable ?
BÉRÉZINE. — Moi ?
LIA. — Souviens-toi !
BÉRÉZINE. — Non, je ne me souviens pas…
LIA. — Cet hiver, pendant une soirée d’étudiants… Guintzburg t’a demandé de le présenter à je ne sais plus quelle étudiante. Une blonde. Tu te souviens ? Elle a demandé : « c’est un youpin ? » Et toi, tu lui as répondu : « C’est vrai qu’il est juif, mais il est tellement bien, mais tellement bien qu’il n’a pas du tout l’air d’être Juif ! »
BÉRÉZINE (confus). — Oui, il y a eu quelque chose comme ça…
LIA. — Pas quelque chose comme ça — exactement ça…
BÉRÉZINE. — Lia, tu veux toujours trouver quelque chose de blessant, et tu le trouves… Est-ce que ça compte, un détail comme ça ?… Tu as une espèce d’amour-propre maladif…
LIA. — Sans doute. Je ne sais pas…Ta réponse, pour moi, elle a été comme une aiguille dans le cœur… Et j’ai pleuré toute la nuit, tellement ça m’a blessée, tellement ça m’a fait mal ! J’ai essayé de me convaincre que je ne t’aimais pas. (Un commis envoyé par le pharmacien chercher sa montre entre dans le magasin, Schloïme passe une peau de chamois sur la montre, l’enveloppe dans du papier et la donne : le commis s’en va.)
BÉRÉZINE (il embrasse la main de Lia). — Mais tu n’as pas réussi à te convaincre, n’est-ce pas ? Tu n’as pas réussi ? Tu m’aimes… Je le sais… (Schloïme jette un coup d’œil dans la salle, secoue la tête avec reproche et, soupirant, retourne vers son établi, mais, de temps en temps, il interrompt son travail pour écouter.)
LIA (à voix basse). — Oh, si je pouvais ne pas t’aimer !… (Elle baisse la tête ; Bérézine, debout près d’elle, lui caresse la tête et essaie de croiser son regard.) Je t’aime pour mon malheur ! (Tressaillant.) Attends ! Écarte-toi ! Quelqu’un… Mon père…
BÉRÉZINE. — Personne… Pourquoi tu as eu si peur ?… c’est pareil…
LIA. — Oh, comme j’ai eu peur !… (Pause.) Je voulais te dire encore… Je ne suis pas croyante… Je n’ai pas la foi… Mais, prendre le baptême, je ne peux pas… Tu m’aimeras quand même, n’est-ce pas ?
BÉRÉZINE. — Quelle question !…
LIA. — Bon, ça, c’est bien ! Ça, c’est bien ! Tant mieux…
BÉRÉZINE. — Si j’ai pu parler de ça, ce n’est pas parce que ça comptait dans notre relation…
LIA. — Non, bien sûr ! Je sais… Ne m’en veuille pas !…
BÉRÉZINE. — Je le disais seulement parce que, sinon, il y aura des milliers d’obstacles et de buissons d’épines sur notre chemin et que j’ai peur que tu te fatigues, ma chérie !
LIA. — Je ne me fatiguerai pas. Et si je me fatigue — je mourrai, et là, je me reposerai… Je ne peux pas prendre le baptême… Tout mon être se dresse contre, et il me semble que si je le faisais, je… me perdrais moi-même, et je te perdrais aussi… (La sonnette automatique résonne dans le magasin, et c’est Nachman qui entre. Lia s’interrompt avec crainte et tressaille.)
LIA. — C’est lui… mon père ! (Elle disparaît dans les pièces intérieures. Bérézine, s’ébouriffant nerveusement les cheveux, marche de long en large dans la salle.)
NACHMAN (répondant au salut de Schloïme). — Bonjour, Schloïme ! Tu travailles ?
SCHLOÏME. — Je travaille. Comment faire autrement, reb Nachman ? Je ne travaille pas, je ne mange pas…
NACHMAN. — Reb Leïser est chez lui ?
SCHLOÏME. — Il n’est pas là. Il est sorti pour affaire — il revient tout de suite… C’est vrai que ça s’agite en Bessarabie et qu’ils préparent un pogrom ?
NACHMAN. — Pour l’instant, il n’y a rien dans les journaux. Mais, à ce qu’on dit, c’est vrai. J’ai un ami qui a reçu une lettre de Kichiniov… C’est très dangereux là-bas : voilà déjà deux semaines que les Juifs vivent dans la peur, les riches cachent leur argent à la banque et s’en vont, et, les pauvres, ils n’ont rien à cacher et nulle part où partir…
SCHLOÏME. — Aïe-aïe-aïe !… Mais pourquoi ils nous cognent dessus ? Est-ce que les Juifs pauvres vivent mieux que les Polonais ou les Russes pauvres ?… Ceux qui ont juste leur oreiller et un hareng par jour, ceux-là, on va leur cogner dessus… Pourquoi ?
NACHMAN. — Oui, Schloïme, Dieu veut nous rappeler que nous sommes Juifs et que nous vivons dans le golus[1] et qu’il est temps que nous pensions à la Terre Sainte. (Ils passent dans la salle.)
SCHLOÏME. — C’est vrai, c’est vrai, reb Nachman ! (Il se rassied à son établi. Nachman salue Bérézine sans mot dire et tous deux déambulent dans la salle, en s’évitant avec inimitié.)
Evguéni Tchirikov
Traduction d’André Markowicz
La collection printemps et vers des éditions Mesures Traductions, vente par abonnement, éditions de leurs propres poèmes…Françoise Morvan et André Markowicz misent sur les fées bretonnes et la confiance des lecteurs.
Par Marie Ndiaye (Libération du 20 avril 2023)
La maison Mesures, éditions fondées en 2019 par Françoise Morvan et André Markowicz, se fonde sur un pari intrépide, tient même de celui-ci, il me semble, sa morale, son principe et son devoir : en s’abonnant pour une année on reçoit cinq livres et l’entière confiance qu’on accorde aux deux éditeurs nous dispense de craindre de ne pas aimer tel ou tel recueil, on sait qu’on les aimera, non pas en dépit du fait que, peut-être, on ne connaisse ni les noms de Aïgui ou de Tchirikov mais presque en raison de cela : deux grands lecteurs nous transmettent l’amour et l’admiration qu’ils éprouvent pour ces auteurs, sentiments d’autant plus trempés, éprouvés, qu’ils les traduisent. Les lecteurs les plus sourcilleux en même temps que les plus délicats, les plus tendres, les plus jaloux de la langue mais, par ailleurs, les plus conciliants envers l’usage parfois original de cette même langue, ne sont-ils pas les traducteurs ?
Méticuleux. Il y a aussi Tsvetaïeva, Shakespeare, Blok, Harms, tous écrivains traduits du russe ou de l’anglais par Morvan et Markowicz. Les livres sont beaux, parfaits ouvrages d’artisansméticuleux, soucieux des détails – papier d’un grège délicat, aquarelle ou fragment d’un tableaucomme un panonceau carré sous le titre.
Françoise Morvan a fait paraître chez Mesures, entre autres, une tétralogie poétique : « Sur champ de sable », tel est le titre mystérieusement héraldique qui rassemble Assomption, Buée, Brumaire, Vigile de décembre. Chaque recueil évoque une Bretagne (on le pressent, on le devine, le nom même n’est jamais cité me semble-t-il) où se coulent furtivement dans les herbes animaux et sylphes, renards et fées, où les vieux meubles vivent et s’expriment dans l’obscurité de maisons vaguement inquiétantes : « Armoire /Pétrie d’un bois de tourbe /Plus amer et dur que le fer /Elle affronte en taureau de forge /Le froid des nuits d’hiver /Mais geint pour s’ouvrir /Mi-fourbe et faible /Feignant sa souffrance /Et sa plainte exaspère. » Aucun « e », aucun « nous » ne prend la parole, seul un « on » discret, ténu mais obstiné, vaillant s’énonce parfois, et c’est ainsi que les poèmes paraissent être écrits au genre neutre – un genre trompeusement doux, faussement paisible comme le silence du village que déchirent soudain des cris ou des pleurs, ceux, imagine-t-on, d’une femme violentée : « L’homme aux mains rudes /Aux lèvres gardant une odeur de vin. »
Je crois volontiers que ce « on » est le pronom par lequel s’incarne la voix intérieure d’une narratrice revoyant en vrai ou en imagination les lieux de l’enfance et réussissant à se mettre au niveau de pensée, de compréhension du monde de la fillette d’autrefois. Cela ne va pas sans douleur souvent, la vie était dure aux enfants et les adultes souvent plus effrayants que lutins, fantômes ou génies. Le temps a passé, des gens sont morts (amis perdus) mais leurs âmes hantent les maisons vides, protectrices ou menaçantes, on ne sait trop. La maison déserté est-elle vendue, quittée à jamais ? Une mélancolie retenue, pudique baigne les pages, ainsi que quelque chose de naturellement altier qui se pose même sur l’objet le plus commun, sur l’être le moins considérable : « Un renard enfouit sa fourrure /Dans le roux des fougères /Et fuit en feu léger /Enfin fiancé à sa puissance /Vers l’orée embuée de bleu.»
Courtoise. Chez Actes Sud, Françoise Morvan a publié « Vie et moeurs des lutins bretons » et « la Douce vie de fées des eaux ». Elle nous encourage, par la grâce d’une écriture courtoise, précise, ni lyrique ni sèche (j’aimerais dire galante) à accueillir sans terreur ni malaise ce dont nous avons parfois l’intuition, quand une aile insaisissable frôle notre joue, quand des pieds menus ou de tout petits sabots invisibles foulent soudain une herbe qu’on voit frémir et se froisser : les follets dansent parmi nous.
Une lecture des « Douze » par Didier Gambert
#DIMANCHES | DANIIL HARMS, MARKOWICZ À VIE, par François Bon
Découvrez Proses et poèmes de Daniil Harms grâce à la chronique de François Bon sur sa chaîne Youtube Tiers Livre, le Studio
Chaîne Youtube Tiers Livre, le Studio
«Bon dimanche», série hebdo parmi les classiques de la littérature
Merci énormément à François Bon !
« Vigile de décembre » sur le Blog Charybde 27
Bouquet final d’un quadriptyque poétique résolument magique, un mois de décembre qui déploie toutes ses volutes noires et enchantées, dans des directions inattendues.
Note de lecture : « Vigile de décembre » – Sur champ de sable IV (Françoise Morvan) par Hugues Robert
Une lecture de « Vigile de décembre » par Didier Gambert
Nous recevons une très belle lecture de Vigile de décembre par Didier Gambert, publiée par la revue en ligne Lichen.
https://lichen-poesie.blogspot.com/p/note-de-lecture_27.html
«Brumaire » un livre de résistance.
Note de lecture : « Brumaire » – Sur champ de sable III (Françoise Morvan) par Hugues Robert sur le blog Charybde
« Buée » sur le blog Charybde 27
Légendes et forêts, pierres du collège et du lavoir, une magie secrète transmute l’enfance en adolescence, en ne la laissant pas se perdre de vue.
Note de lecture : « Buée » – Sur champ de sable II (Françoise Morvan)
Entretien avec André Markowicz par Isabelle Baladine Howald sur Poezibao
Un entretien d’Isabelle Baladine Howald avec André Markowicz à propos des éditions Mesures et des premiers titres de la maison.